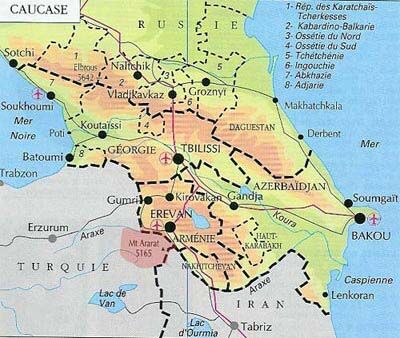Noé fait alliance - Espace temps
En voici deux :
1. Le récit mésopotamien
Le récit du déluge se retrouve dans d’autres civilisations dont les plus anciennes, par exemple en Mésopotamie, le berceau de l’humanité. Parmi ces récits, le plus célèbre est celui de l’épopée de Gilgamesh.
Cette épopée est relatée dans douze chapitres, dont la majorité furent découverts au 19e siècle à Ninive dans les ruines du temple de Nabou, et dans la bibliothèque du palais d’Assourbanipal. Gilgamesh fut un jeune roi d’Ourouk (1ière dynastie sumérienne) ; par son ascendance Gilgamesh est présenté comme un demi-dieu.
La narration débute par les exploits et la destinée du héros. C’était un être d’une grande sagesse et d’une non moins grande connaissance. Gilgamesh se mit en quête de l’immortalité, mais au terme d’un long voyage, la lassitude eut raison de lui, et il se résigna à rentrer dans son pays. Là, il grava sur une tablette de pierre le récit de son voyage, et acheva de construire sa ville, Ourouk.
La 9ème tablette du récit présente Gilgamesh terrifié par la mort et errant dans la nature. Il décide d’aller trouver un personnage censé avoir survécu au déluge avec son épouse Out-napishtim, afin de connaître le secret de la vie éternelle.
Puis le personnage lui raconte comment les choses se sont passées quand les dieux décidèrent d’inonder l’humanité. L’un des dieux, Ea, l’avertit de l’imminence du danger en disant :
« Homme de Shourouppak, fils d’Oubara-toutou, démolis ta maison, construis un bateau. Laisse les possessions, recherche les choses vivantes. Abandonne les biens et sauve les vies ! Prends à bord les semences de toutes les choses vivantes, dans le bateau. »
Puis, Out-napishtim raconte la suite à Gilgamesh :
« Je mis à bord toute ma famille et ma parenté, je mis à bord du bétail de la plaine, des bêtes sauvages de la plaine, toutes sortes d’artisans…Durant six jours et sept nuits, le vent souffla, tempête et inondation submergèrent le pays ; quand vint le septième jour, la tempête, l’inondation et la tuerie, qui avaient lutté comme une femme en travail, s’évanouirent. La mer se calma, le vent imhoullou s’apaisa, l’inondation s’arrêta. Je regardais le temps dehors ; le silence régnait. Car toute l’humanité était redevenue argile. La plaine d’inondation était plate comme un toit. J’ouvris un hublot et la lumière tomba sur mes joues. Je me courbais, puis m’assis. Je pleurai. »
Ensuite, Out-napishtim laisse sortir une colombe, puis une hirondelle, et toutes deux reviennent. Il envoie alors un corbeau qui, lui, ne revient pas. C’est signe que les eaux se sont enfin retirées. On voit la ressemblance avec le personnage de Noé dans le récit biblique du déluge.
2. Le récit grec
La méchanceté des hommes, particulièrement celle des Arcadiens et de leur roi Lycaon, détermina Zeus à dévaster la terre par le déluge. Mais Prométhée, bienfaiteur des hommes, suggéra à son fils Deucalion de construire un bateau. Il flotta neuf jours et neuf nuits pour s’échouer enfin au sommet du Parnasse ou près de Dodone.
En débarquant, Deucalion et sa femme Pyrrha firent un sacrifice de reconnaissance à Zeus mais furent bien surpris de se retrouver seuls. Selon l’une des variantes du récit, Hermès, messager de Zeus, vint leur demander ce qu’ils désiraient. « Une nouvelle race d’hommes », répondirent-ils. Alors leur interlocuteur leur dit de lancer les os de leur mère par-dessus leur épaule en se voilant la tête et en dénouant leur ceinture. Ils hésitaient devant le sacrilège, croyant qu’il s’agissait des os des morts. Mais Deucalion comprit qu’il s’agissait de la Terre, mère des hommes, et que les os étaient des pierres. Deucalion donna naissance à des hommes et Pyrrha à des femmes. Cette nouvelle race fut celle des Lélèges. Deucalion et Pyrrha s’installèrent en Locride et y fondèrent une famille.
Pour éviter la disparition de plus de 3 000 espèces animales et de plus de 40 000 espèces végétales sauvages de notre planète, la communauté internationale s’est mobilisée. En 1973, inquiets de la menace de disparition de certaines espèces animales et végétales sauvages, 39 Etats, dont la France, signèrent à Washington une convention visant à réglementer voire à interdire le commerce international (importation, exportation et réexportation) de ces espèces ainsi que des parties et produits qui en sont issus (peaux, fourrures, plumes, ivoires, trophées, bois, fleurs, objets d’art, plats cuisinés…).
Ratifiée en 1978 par la France, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) est aujourd’hui en vigueur dans plus de 140 pays.