Responsable de ce qui m’arrive? - Contexte

Souvent, on a reproché à la religion de refuser à l’être humain d’exercer sa liberté ou plus exactement son libre arbitre. L’être humain n’étant pas capable de choisir librement le bien, il lui faudrait une tutelle, une instance, en l’occurrence la religion, qui le guide et lui prescrive les choix à faire en matière politique, morale, personnelle. Cette prétention de la religion a été contestée par les philosophes des Lumières. Ils considèrent que l’être humain est libre de ses choix, libre de prendre tel chemin ou tel autre, libre et par conséquent responsable devant ce qui arrive. Ils mettent en garde contre toute instance réduisant l’être humain à un » mouton » condamné à suivre le troupeau et son berger. Toutefois malgré son caractère optimiste et séduisant, cette position n’est pas sans poser question. L’être humain est-il vraiment libre de tout déterminisme, qu’il soit social, génétique, psychologique ou encore éducatif ?
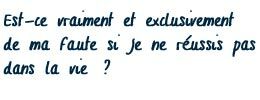
D’une manière générale, affirmer que l’être humain n’est pas un être passif, prédestiné à subir ce qui lui arrive, semble plutôt un progrès et une percée libératrice. Celui qui refuse de se considérer comme fatalement pris dans une histoire qu’il n’a pas choisie peut alors avancer dans la vie, découvrir des possibilités jusqu’alors inconnues et penser sa vie en dehors des déterminismes qui semblent vouloir l’enfermer dans la répétition. Toutefois, affirmer que l’être humain est responsable de sa vie va aujourd’hui souvent de pair avec un impératif de réussite qui commence déjà à l’école. Cette volonté de » se faire un nom » par soi-même est déjà présente -et sévèrement critiquée- dans la Bible. Elle devient omniprésente dans une société qui glorifie le self made man, » celui qui a fait sa vie « , et où règne en conséquence une logique de performance et de concurrence entre les individus. Ceux qui refusent d’entrer dans cette logique ou tout simplement qui n’y parviennent pas, ceux qui ne réussissent pas, qui accumulent malheurs (et/ou maladies) sont exclus. Et le poids que représente leur échec devient insupportable. Il ou elle se pose alors la question : » Quelle faute ai-je commise pour ne pas réussir comme d’autres ? » Ou alors, avec un peu de lucidité : » Est-ce vraiment et exclusivement de ma faute si je ne réussis pas dans la vie ? » Quant à ceux qui réussissent, on peut s’interroger -et eux-mêmes parfois s’interrogent- sur le sens de cette réussite et le bonheur, la plénitude, la satisfaction qu’elle apporte, et quel en est le prix à payer.

On peut lire dans les faits divers des événements portés devant la justice qui surprennent à première vue. Au lieu d’engager sa propre responsabilité (et son bon sens…) dans un accident, une difficulté, voire un malheur qui est arrivé, on réclame justice auprès de tiers. Ainsi, cette dame qui a utilisé un micro-onde pour sécher son chat fait venir son cas devant la justice et obtient gain de cause. Désormais, les fabricants de micro-ondes doivent signaler dans la notice accompagnant l’appareil qu’il ne faut pas placer des êtres vivants dans celui-ci…
On constate une demande de plus en plus forte d’assurance tout risque contre toute sorte de maux ; une tendance croissante à établir nécessairement la culpabilité d’un tiers. Ainsi, même à la suite d’une catastrophe naturelle, on voit les victimes se retourner contre celui ou celle qui aurait dû mieux prévoir la situation et parer à ses conséquences. »
Ces exemples montrent qu’il devient de plus en plus difficile d’accepter le risque lié à la vie. Et au lieu d’assumer la fragilité de la vie, on applique la logique selon laquelle chaque malheur est nécessairement la conséquence d’une faute. Il y a d’ailleurs là un paradoxe : d’un côté l’individu moderne revendique de plus en plus de liberté et de l’autre il demande à être de plus en plus assisté.

Si on peut critiquer la tendance à la judiciarisation de la société, on doit toutefois reconnaître au procès une fonction positive : mettre des paroles sur les torts subis, qu’ils soient justifiés ou non d’un point de vue extérieur. On constate d’ailleurs que le possible rétablissement de la victime et le retour à une vie apaisée ne tient pas tant à la gravité de la peine infligée qu’à la mise en scène publique de l’injustice. Celle-ci est ainsi sortie du domaine du ressenti personnel, privé et secret. Très souvent, on entend : » Le plus important, c’est d’avoir pu le dire dans un espace public où on m’a écouté « .

Parmi les différentes réponses que l’être humain trouve au malheur qui le frappe ou qui frappe son entourage, il y a celle qui considère que le mal » sert nécessairement à quelque chose « . Des proverbes multiples vont dans ce sens. Il est essentiel de réaliser que ce genre d’expression participe souvent à une culpabilisation supplémentaire de celui qui est frappé par le malheur. Certes, après-coup, on peut parfois dire qu’une situation dramatiquement vécue a finalement débouché sur quelque chose de positif. Mais de là à en faire une sorte de principe appliqué a priori et sans discernement, il y a un pas considérable qui est malheureusement souvent franchi. Au lieu d’entendre la plainte du souffrant, on cherche alors à plaquer des soi-disant réponses qui ne consolent pas, mais qui peuvent apparaître totalement cyniques et scandaleuses aux yeux de celui qui souffre. Car cela revient à déclarer non seulement qu’un malheur n’est pas foncièrement négatif, mais qu’il n’est finalement qu’un bonheur déguisé. Ce qui se présente comme » parole de sagesse » est en fait une imposture méprisant l’être humain et la réalité de la souffrance.
Une des compréhensions du malheur lie celui-ci au péché. Il importe d’abord de définir ce qu’on entend par ce mot. Car il y a péché et péché… Il y a d’abord le langage courant qui appelle péché une faute, plus ou moins grave, au niveau moral. La logique la plus simple qui lie malheur (ou maladie) et péché est celle que l’on pourrait appeler rétributive. Elle postule un dieu tout puissant, voyant tout, sachant tout et qui punit celui qui transgresse ses lois. Un dieu qui par ailleurs va s’appuyer sur la culpabilité et la peur du transgresseur. Cette logique fonctionne aussi avec d’autres d’intermédiaires, qu’ils soient religieux ou pas (idéologie, valeur morale, principe philosophique…).
Mais il y a d’autres compréhensions du péché. En particulier celle pour laquelle le péché n’est pas une faute morale plus ou moins consciente, mais bien une sorte de condition originelle de l’être humain. Celui-ci cherche à trouver reconnaissance et amour ; toujours insatisfait il s’abandonne pour y parvenir à des illusions multiples et plus ou moins décevantes. Ici, il n’est pas question d’une faute à punir, mais d’une sorte de malheur » au départ « , d’un malaise, un mal-être (Eric Fuchs) aboutissant à l’enchaînement et la répétition de situations malheureuses.

