Violence, de quoi parle-t-on? - Contexte

La question de la violence est » à la mode » aujourd’hui. Pourquoi ? Y aurait-il réellement plus de violence aujourd’hui qu’autrefois ? Il importe de distinguer la violence et le sentiment d’insécurité. En effet, l’augmentation du sentiment d’insécurité n’est pas en rapport avec la réalité de la violence qui, elle, a tendance à diminuer, dans sa forme criminelle en tout cas.
Il est nécessaire de distinguer violences collectives et violences individuelles. Si, pour les guerres, les atrocités du 20e siècle l’emportent largement sur toutes les autres périodes de l’histoire, il n’en est rien pour ce qui concerne la violence privée, c’est-à-dire le crime, la violence familiale, etc. On constate, surtout depuis le 19e siècle, une diminution très nette des homicides.
Les chiffres sont toujours dangereux à utiliser, en particulier sur le court terme. Selon les critères de comptabilité, selon les enjeux électoraux, selon le degré de politique répressive d’un gouvernement, les chiffres ne traduisent pas de la même manière la même réalité. Si l’on constate aujourd’hui une augmentation inquiétante de la violence urbaine, de la délinquance juvénile, du déficit des processus d’intégration, de la paupérisation…, sur la longue distance cependant, il importe de noter le progrès de sécurité, la baisse de violence individuelle.
Cette diminution de la violence est due essentiellement au développement du contrôle étatique (police, justice) et à l’amélioration des conditions économiques (diminution de la mortalité, recul de la faim). L’est-elle aussi par un progrès culturel, une amélioration de l’être humain ?

» L’histoire de la violence contredit l’imaginaire social, nourri de préjugés et de nostalgies millénaires, toujours rebelle à admettre les vérités élémentaires, même (et parfois surtout) quand il s’agit de vérités d’évidence : il y a eu, au cours des derniers siècles, une régression considérable de la violence criminelle. » (Chesnais, Jean-Claude,
Au Moyen Age, la vie quotidienne était extrêmement violente : » Les documents suggèrent d’inimaginables déchaînements affectifs où chacun quand il le peut s’abandonne aux joies extrêmes de la férocité, du meurtre, de la torture, de la destruction et du sadisme… » (Elias, Norbert,
En France, la fréquence des crimes est deux fois et demie moins élevée qu’elle ne l’était en 1830. A Oxford (Angleterre), le taux d’homicide au 13e siècle oscillait entre 35 et 70 pour 100000, c’est-à-dire quatre à sept fois plus élevé que dans les métropoles américaines d’aujourd’hui… L’insécurité des rues était chose courante au 19e siècle, en témoignent les romans de Zola ou de Dickens.
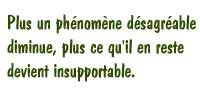
Alors que la violence individuelle diminue, l’opinion majoritaire a l’impression qu’elle augmente. D’où vient ce décalage entre la réalité constatée et la perception que l’on en a, beaucoup plus subjective ? Le sentiment d’insécurité est complexe. Il renvoie à un rapport psychologique à la réalité, à une angoisse devant la violence.
Sans doute le sentiment d’insécurité est-il plus fort aujourd’hui que par le passé à cause des médias, qui rendent spectaculaire, immédiate la violence, donnant l’illusion d’une violence répandue, à nos portes, dans notre salon même. L’image envahit l’imaginaire, le fantasme se confond avec la réalité, l’angoisse devient vérité.
Le miroir des médias déforme la réalité. Par exemple, c’est dans les pays où la femme est la plus émancipée que l’information sur les femmes battues circule, donnant l’impression paradoxale que c’est là qu’il y a le plus de violence domestique.
Certaines formes de violences privées -en particulier les violences sexuelles- semblent augmenter. On peut se demander dans quelle mesure cela n’est pas le produit d’un biais statistique introduit ici à la fois par l’efficacité croissante des moyens d’investigation judiciaire et par la levée progressive d’une » loi du silence » qui jusqu’alors pesait sur les victimes.
L’opinion selon laquelle la violence augmente vient aussi d’une attente de plus en plus grande de sécurité dans tous les domaines de la vie quotidienne. Les assurances se multiplient, on cherche le risque zéro… Et en même temps la solidarité qui, autrefois, atténuait la réalité de la violence, tend à s’amoindrir. La perte de cohésion sociale fragilise les plus vulnérables, qui ont le sentiment que pour eux le monde est plus dangereux. On sait combien il est tentant pour les hommes politiques d’exploiter le filon de l’insécurité.
Jean-Claude Chesnais insiste sur un autre facteur : plus un phénomène désagréable diminue, plus ce qu’il en reste devient insupportable. C’est comme si le seuil de tolérance à la violence diminuait avec la diminution de la violence elle-même.
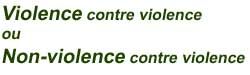
Contre la violence structurelle, celle de la société ou de l’organisation du groupe dans lequel on vit, une autre violence peut surgir, directe, liée à une action, à un acte, à un » faire « . Cette violence peut être délibérée, quand elle sert comme un outil, organisé en révolution ou désorganisé en révolte. Elle peut être aussi sans but : c’est la violence symptôme, qui dit le mal de vivre retourné contre la société (vandalisme) ou contre soi-même (suicide, folie). » Il y a des violences stratégiques et donc perdables, qui conjoignent des moyens de force et des buts volontaires et partagés, comme il y a des violences qui sont des cris, des expressions, des témoignages de la douleur de vivre ensemble mutuellement obligés, en ville, en société marchande, mais aussi en famille ou en amour. Il y a la violence « pacificatrice », qui refuse, nie et écrase les conflits, les différends ; et il y a la violence qui en rajoute sur l’irréparable, manière de croire que l’on en est encore acteur. » (Olivier Abel)
L’évêque brésilien Don Helder Camara (1909-1999) parlait d’un cycle de la violence ; il distinguait 3 niveaux de violence qui s’emboîtaient les unes dans les autres, s’alimentant mutuellement en un cercle vicieux (voir le film American History X): la violence de la structure, qui entraîne en réaction la violence de la révolte, qui elle même suscite la violence de la répression… Laquelle souvent renforce la violence structurelle, etc… Contre ce cycle infernal , s’est développé le concept de » non-violence « . Il s’agit de casser le cycle en substituant à la violence de la révolte une méthode d’action qui n’utilise pas les moyens violents.

Le 10 novembre 1998, l’assemblée générale de l’O.N.U. a voté une résolution déclarant la décennie 2001-2010 » Décennie internationale pour la promotion d’une culture de non-violence et de paix au profit des enfants du monde « . Cette décennie » doit nous motiver tous encore plus à réaffirmer notre attachement aux idéaux de paix, dans tous les sens du terme, idéaux dont les Nations Unies ont été le symbole tout au long de leur histoire. Pour cela, il nous faut envisager la paix sous plusieurs perspectives, et nous souvenir que pour gagner une paix durable, il faut combattre sur plusieurs fronts : pour libérer l’humanité du fléau de la guerre, de la misère, phénomène abject et déshumanisant, et de la menace d’avoir à vivre sur une planète polluée où il ne reste guère de ressources naturelles. » (Kofi Annan, secrétaire général de l’O.N.U.)
En décembre 1998, lors de son assemblée d’Harare (Zimbabwe), le Conseil œcuménique des Eglises a proclamé les années 2001-2010 » Décennie pour surmonter la violence « . Il s’agit d’inviter les Eglises membres, essentiellement protestantes et orthodoxes, à réfléchir, travailler et prier pour la paix. » Appeler à construire une « culture de non-violence » de nos jours, c’est avant tout manifester une protestation. Un refus des modèles culturels dominants qui favorisent ou excusent la violence, dans ses manifestations directes autant que structurelles. C’est un appel à démasquer et à nommer les prétendues valeurs du pouvoir, du désir de posséder toujours plus, de la recherche d’intérêts individuels, en fonction des conséquences destructrices qu’elles provoquent […]. Cette culture nouvelle doit s’enraciner dans une spiritualité du discernement et d’engagement pour la vérité. » (Konrad Raiser, secrétaire général du C.O.E.)
En France, le thème de la » Décennie pour surmonter la violence » a été au cœur des Assises de la Fédération Protestante de France (Clermont-Ferrand, 8-10 octobre 2004).

Le concept et les méthodes de non-violence se sont développés au 20e siècle, à travers deux figures principales. Gandhi
Avocat indien né en 1869. Dans son combat contre le racisme en Afrique du Sud, puis pour l'indépendance de l'Inde, il a développé les principes et les techniques de la non-violence. (1869-1948) a utilisé la non-violence pour libérer l’Inde de la colonisation anglaise (voir le film « Gandhi« ). Martin Luther King
Pasteur baptiste noir américain né en 1929. Il a lutté contre la discrimination raciale aux Etats-Unis au moyen de méthodes non-violentes inspirées de sa lecture de l'Evangile et de l'expérience de : boycott, manifestations, sit-in, grèves, désobéissance civile. (1929-1968) l’a pratiquée pour mettre fin à la ségrégation des Noirs aux Etats-Unis. A leur suite, de nombreuses actions d’émancipation se sont servi des mêmes méthodes.
La non-violence est pour certains une philosophie de vie, basée sur le refus de la violence. Elle puise ses racines dans la Bible, dans le bouddhisme, dans l’hindouisme.
Pour d’autres, il s’agit essentiellement d’une méthode de lutte, d’une manière de gérer les conflits qui utilise d’autres moyens que la violence. Différentes actions peuvent pousser l’adversaire à renoncer à l’oppression dont il est l’auteur : sit-in, actions symboliques, désobéissance civile, grève de la faim. Le poids de l’opinion publique est essentiel dans ce rapport de force où le non-violent accepte de subir coups ou prison, injustement.
La visée de la non-violence est de gérer le conflit, de faire reculer l’injustice, et, au-delà, d’en appeler à la conscience de l’adversaire pour le convertir.
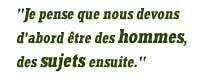
Si certaines violences sont légales (au regard de la loi), elles ne sont pas forcément légitimes (au regard de la morale).
C’est par l’application de lois que le nazisme est parvenu au pouvoir, puis a légalisé la Shoah. Une loi peut être fondamentalement injuste et cautionner des violences intolérables.
La distinction entre légalité et légitimité est un des fondements de la non-violence. Elle a été conceptualisée par Henry David Thoreau dans son livre La désobéissance civile (1849). Pour lui, la conscience du bien passe avant le respect de la loi ; si ma conscience s’oppose à une loi, je dois obéir d’abord à ma conscience (voir le film « I comme Icare« ) : » Le citoyen doit-il un seul instant, dans quelque mesure que ce soit, abandonner sa conscience au législateur ? Pourquoi, alors, chacun aurait-il une conscience ? Je pense que nous devons d’abord être des hommes, des sujets ensuite. Le respect de la loi vient après celui du droit. La seule obligation que j’aie le droit d’adopter, c’est d’agir à tout moment selon ce qui me paraît juste. » (Thoreau)
Le synode de l’Eglise réformée de France, réuni à Nantes en mai 1998 a débattu de la question des étrangers dans notre pays. Il a invité les membres de l’Eglise à » assumer leur double citoyenneté, spirituelle et séculière, et à exercer leur loyauté critique dans un Etat de droit, sans exclure en dernier recours des actions non-violentes de désobéissance civile personnelles ou collectives « .
